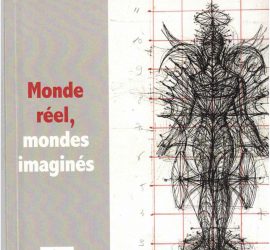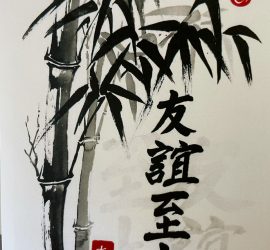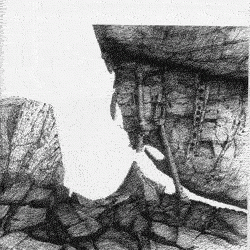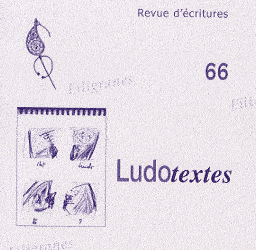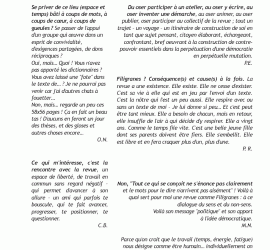Monde réel, mondes imaginé (Hors série)
Ce numéro est financé par la DLV Agglo (Manosque) Il est en accès libre Édito Carzou, monde réel / monde imaginaire L’artiste crée une œuvre qui doit être complétée par son public et est, par conséquence nécessairement imparfaite : c’est par les vides de l’œuvre que le lecteur y insuffle la vie. (Alberto Manguel, L’Apocalypse selon Dürer, Éditions Invenit, 2015) La première fois qu’on entre, on est un peu écrasé, oppressé par l’immensité des peintures. Il faut prendre le temps de digérer, au sortir ou à l’entrée de temps apocalyptiques, pour commencer à voir derrière l’œuvre de Carzou toute la symbolique qu’elle nous révèle, conformément au sens étymologique du grec « apokalupsis » révélation, le verbe « apokaluptein » signifiant découvrir. Le travail, par son ampleur et sa symbolique, ne laisse personne indifférent. Mais pour cela, il doit venir chatouiller l’imaginaire des passants qui s’y aventurent. C’est cette rencontre entre l’œuvre monumentale et l’art d’écrire que la revue Filigranes a mis en place lors des Correspondances 2024 : déambuler, se laisser imprégner, et puis écrire, partager, découvrir la résonance secrète entre les mots et les peintures. Une heure en immersion, errer dans la chapelle en laissant venir les mots, non pour […]